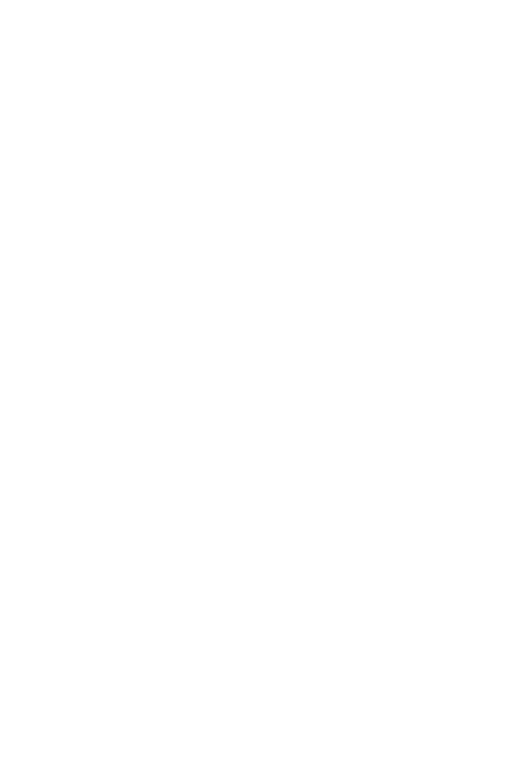Comme le dit si bien Hannah Arendt, « le pouvoir réel commence où le secret commence [19]». Même quand des spécialistes de la surveillance tels que Jean-Marc Manach et Jérôme Thorel ne parviennent pas à déceler des informations sur les processus techniques qui ont cours dans les agences de sécurité [20], il faut bien avouer que le secret en vigueur dans le secteur sécuritaire fonctionne à merveille. Comme le dit, par ailleurs, Julian Assange, le secret sert à ralentir les processus et à mieux contrôler. [21] Il a également pour vocation de générer une interface de normalité qui atténue l’horreur effective. [22] Le culte du secret est en ce sens plus efficace que l’endoctrinement : il masque les agirs réels et crée un mirage dans lequel le secteur sécuritaire aurait pour vocation de se battre contre, Il existe une loi en France qui permet de récolter des informations sur un individu pour profilage, pendant une période de douze mois. Dans ce genre de cas, l’ordinateur du suspect est absorbé par des programmes et ses informations précisément analysées.
Or, comme dit précédemment, les agences de sécurité privée privilégient très nettement les intérêts des entreprises mandantes à de telles luttes.
Innovation technologique, un exemplier
L’avancée des développements technologiques en matière de surveillance renforcent les raisons de s’inquiéter. Les drones, ordinairement construits comme des avions téléguidés, sont en phase de miniaturisation. Ceux-ci, grâce à l’avancée dans la recherche nanotechnologique, peuvent mesurer de « quelques millimètres à quelques décimètres d’envergure [23] ».
Afin de maximiser leur indiscernabilité dans l‘environnement dans lequel ils sont guidés, ces mini-drones peuvent prendre la forme de mouches, de moucherons, de moustiques, ou de libellules. [24] L’industrie militaire développe également des mini-robots pouvant aller jusqu’à une dimension submillimétrique, ayant la possibilité de se déplacer avec « des flagelles, des pattes, une ondulation ou simplement portés par le vent », dans lesquels peuvent être implantés des morceaux d’organes sensoriels, bien plus efficaces que les capteurs électroniques. [25]
Le complexe militaro-industriel cherche même à développer des drones invisibles, non-perceptibles car créés à une échelle nanométrique. [26] Les formations dites d’essaim (swarm-bots) prolifèrent dans le domaine de la (nano-) robotique. L’EPFL a inventé des nano-robots capables de se déplacer en essaim, et d’interagir avec le vivant [27]. Claytronique, en partenariat avec l’Université Carnegie Mellon, cherche à créer des « catomes », essaim de petites sphères « possédant une autonomie énergétique, des capacités de calcul et d’association avec d’autres catomes [28] ». Les projets de l‘armée ne s‘arrêtent pas à la micro-/nano-électronique : l‘armée s‘attaque également au monde animalier. Elle intègre des dispositifs de surveillance sur des insectes, mais également sur des requins, des rats, des « essaims de frelons bioniques [29] », afin de les rendre pilotables et de capter des données par leur biais.
Appareillage panoptique
De tels développements technologiques ne sont pas sans conséquence sur la vie quotidienne des individus. Si des technologies comme les drones-moucherons venaient à être utilisés de façon massive, nous assisterions à une extension d’un effet psychologique bien connu, le panoptisme. Le panoptisme est bien plus qu’une architecture : c’est une stratégie psychologique qui confère aux regardants une nouvelle manière d’intensifier et de perfectionner l’exercice du pouvoir [30]. Retors, il stimule l’imaginaire du regardé, qui ne se sent plus observé de manière discontinue, comme c’était ordinairement le cas, avant la création de la machinerie panoptique (c’est-à-dire avant le XIXe siècle). Cette continuité est apparente, car en réalité, les surveillants n’espionnent leurs détenus que de façon irrégulière. Le regardé sent au-dessus de sa nuque un oeil qui l’observe de manière constante, qui épie les moindres de ses faits gestes. Ce regard en survol est en réalité fictionnel. Il est co-crée par le regardé et par le dispositif de contrôle.
« L‘inspection, voilà le principe unique, et pour établir l‘ordre et le conserver ; mais une inspection d‘un genre nouveau, qui frappe l‘imagination plutôt que les sens, qui mette des centaines d‘hommes dans la dépendance d‘un seul, en donnant à ce seul homme une sorte de présence universelle dans l‘enceinte de son domaine. » [31]
N’ayant connaissance du nombre de regardeurs, de la fréquence et de l’intensité des observations, le regardé va imaginer cet oeil planant, et modifier son comportement en conséquence. Il s’agit d’une stratégie qui joue avec l’imaginaire du regardé, qui induit un sentiment de traque et qui prend son effet à l’intérieur de son esprit. [32] Ainsi, la personne observée intègre des schèmes de pouvoir :
« Celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le sait, reprend à son compte les contraintes du pouvoir ; il les fait jouer spontanément sur lui-même ; il inscrit en soi le rapport de pouvoir dans lequel il joue simultanément les deux rôles ; il devient le principe de son propre assujettissement. » [33]
Le rapport de pouvoir que subit le regardé s’exerce sans le concours direct du surveillant. Le regardé se retrouve seul, en lutte avec cet oeil intérieur qui le passe au crible de façon continuelle ; il s’agit d’une surveillance intériorisée, qui s’exerce « sur et contre lui-même ». [34]
Le panoptique génère pour les surveillants un effet de transparence généralisée, qui rend translucide les murs, et les agirs des regardés. Néanmoins, le regardé se confronte à une dense opacité : ses surveillants sont devenus fantomatiques. Impossible par conséquent de savoir quand et pourquoi ils l’observent. C’est justement là qu’intervient l’imaginaire. Face à un trou d’informations, la faculté imaginative du regardé s’emballe, et crée un effet oppressif, sans moindre pause.
Ce mécanisme peut aller très loin : l’observé peut avoir l’impression que toutes ses mimiques sont soigneusement analysées, voire que ses pensées sont enregistrés par un dispositif obscur. L’effet du panoptisme n’a pas de limite. Quand bien même le regardé serait sorti de l’architecture carcérale panoptique, il pourrait par réflexe se sentir encore surveillé ; son imaginaire trouverait une justification pour qu’il continue à y croire. Les modifications comportementales ont possiblement plusieurs causes : elles peuvent provenir d’une volonté de se montrer sous son meilleur jour (en tant que non-délinquant), elles peuvent être induites par la volonté de cacher quelque chose au surveillant, elles peuvent prendre racine dans le besoin de conserver quelques bribes d’intimité, etc. Les conséquences sont elles-mêmes multiples : le regardé modifie sa manière de se mouvoir, il observe constamment ses paroles, qu’il adapte de façon à ne pas trop divulguer d’informations ou pour plaire à ses surveillants, il devient perméable à l’autorité et se soumet plus facilement.
Le programme de Jeremy Bentham est bien clair : son but est d’agir sur l’esprit même du détenu, pour le modifier, le redresser, le rectifier aux normes de la société. « Être incessamment sous les yeux d‘un inspecteur, c‘est perdre en effet la puissance de faire le mal et presque la pensée de le vouloir [35] ». Il s’agit en somme de transformer les détenus en « hommes nouveaux [36] ». Cette idée que les individus ne feront pas la mal tant qu‘ils sont placés dans un champ de visibilité accru provient en réalité de la Révolution Française. [37] Cependant, les objectifs propres au mécanisme du panoptique diffère considérablement d’une volonté de secourir une société déviante. En fait, le but du panoptique est plutôt de faire croître la production et l’économie. [38] Jeremy Bentham est plutôt clair sur la question : « Le principe panoptique peut s‘adapter avec succès à tous les établissements où l‘on doit réunir l‘inspection et l‘économie. » [39] Ce qui implique de nos jours un nombre incommensurable d’entreprises et d’institutions…
Dans tous les cas, le panoptique est un appareillage qui modifie considérablement la nature du pouvoir exercé. En effet, il « automatise et désindividualise le pouvoir ». [40] Il rend son exercice beaucoup plus léger [41], plus subtil et plus souple ; « il tend à l’incorporel ». [42] Il est important de noter que le pouvoir tient plus à la manière dont les échelons s‘articulent, s‘auto-influencent [43]. Il n’est plus important de savoir qui l’exerce ; ce qui compte avant tout, c’est le bon fonctionnement et la conservation de l’appareillage. [44]
Références
[19] Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme : Le système totalitaire, op.cit., p. 188
[20] Jean-Marc Manach et Jérôme Thorel, « NSA, Prism et consorts : quoi de neuf ? », op.cit. [7:34]
[21] Julian Assange, Menace sur nos libertés : comment Internet nous surveille, comment résister, op.cit., p. 33
[22] Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme : Le système totalitaire, op.cit., p. 130
[23] Bernard Claverie, L’homme augmenté, néotechnologies pour un dépassement du corps et de la pensée, op.cit., p. 44
[24] Dorothée Benoit Browaeys, Le Meilleur des nanomondes, éditions Buchet/Chastel, Paris, 2009, p. 221
[25] Ibid. p. 219
[26] Ibid. p. 218
[27] Ibid. p. 125
[28] Ibid. p. 125
[29] Ibid., p. 219
[30] Michel Foucault, Surveiller et punir, op.cit., p. 240
[31] Jeremy Bentham, Le panoptique, précédé de « L’oeil du pouvoir », entretien avec Michel Foucault / Post-face de Michelle Perrot, éditions P. Belfond, Paris, 1977, p. 41
[32] Ibid., p. 240
[33] Ibid., p. 236
[34] Michel Foucault, Surveiller et punir, op.cit., p. 19
[35] Jeremy Bentham, Le panoptique, op.cit., p. 42
[36] Ibid., p. 85
[37] Ibid., p. 17
[38] Michel Foucault, Surveiller et punir, op.cit., p. 24
[39] Jeremy Bentham, Le panoptique, op.cit., p. 89
[40] Michel Foucault, Surveiller et punir, op.cit., p. 235
[41] Ibid., p. 244
[42] Ibid., p. 236
[43]Jeremy Bentham, Le panoptique, op.cit., p. 24
[44] Michel Foucault, Surveiller et punir, op.cit., pp. 235-236