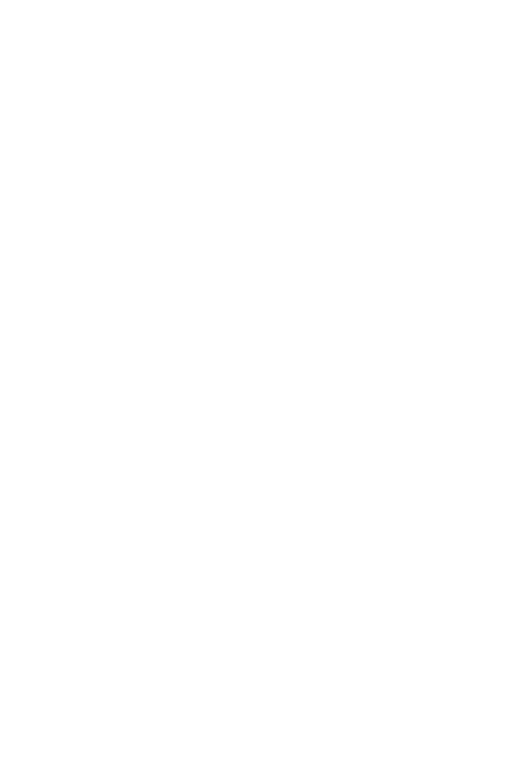Malgré le fait que Soupault s’engagera à ne plus écrire de bouquins, à ne plus participer à des revues bourgeoises et à adhérer au P.C., il sera exclu par le groupe surréaliste, sur sa demande explicite :
« Il y a parmi vous une méfiance contre moi plus personnelle que justifiée, car enfin si mes romans sont contre-révolutionnaires, ils peuvent quand même avoir une certaine excuse. Etant donné cette défiance, je demande à être exclu du surréalisme. Mais qu’on me fasse confiance comme communiste. » [27]
Reste qu’à l’issue de cette réunion, les membres non-exclus sont tous idéologiquement liés au marxisme-léninisme. La majorité d’entre eux pensent encore à cette époque adhérer au P.C. Si le motif de leur adhésion est avant tout idéologique, celui-ci glissera progressivement vers un ordre stratégique. En effet, les surréalistes nourrissent à propos du Parti les velléités d’être actifs dans la gestion de sa politique culturelle [28] . Le Parti communiste n’ayant à cette époque pas encore établi de ligne culturelle, les surréalistes escomptent donner une impulsion avant-gardiste au champ des prescriptions soviétiques. Non seulement ils veulent se devenir instance de légitimation pour les arts d’avant-gardes d’époque ou d’avenir, mais ils cherchent par ce même biais leur propre reconnaissance. [29] Les productions surréalistes sont relativement appréciées par le mouvement bolchevique en 1925. Lénine et Trotsky considèrent à cette époque qu’il est primordial d’instaurer un pluralisme artistique et littéraire. [30] Néanmoins, cette attitude favorable va rapidement décliner. En premier lieu, le désir d’autonomie du surréalisme [31] vis-à-vis du parti va contraster avec le devoir disciplinaire et de soumission aux décisions de la majorité ; cette autonomie reste néanmoins la condition d’adhésion des surréalistes. Le non-bénéfice de cette condition va les mener à réfléchir en ces termes :
« Vis-à-vis du PCF. Ne jamais en faire partie – être en dehors de lui pour pouvoir le dominer, – être tout naturellement à l’extrême gauche, – ne pas oublier que pour nous les communistes doivent représenter les mencheviks, – notre adhésion au PC serait un acte aussi antirévolutionnaire que l’est la représentation du PC à la Chambre, – mener une action parallèle à celle du PC, éviter de l’attaquer directement, mais rester tout à fait indépendant de lui. » [32]
Dans un même ordre d’idées, les surréalistes considèrent qu’il ne s’agit pas en soi de participer à une révolution mais bel et bien de la diriger. [33] Il est par conséquent possible que les surréalistes ne soient pas seulement des romantiques révolutionnaires, mais qu’ils nourrissent parallèlement une logique de pouvoir. En réaction, le Parti, se doutant rapidement de leurs préoccupations, ne souhaite d’aucune manière se laisser influencer par des intellectuels provocateurs, et surtout non-communistes. [34] De plus, les membres du Parti communiste considèrent les surréalistes comme très individualistes [35] et reprocheront leur affiliation avec Freud [36], référence évidemment propice à leurs explorations psychiques. Les choses se compliquent rapidement entre les deux mouvements. La direction culturelle se prononce en faveur des compagnons de route [37], mouvement populiste dirigé par un certain Barbusse. [38] Les surréalistes se mettent rapidement à critiquer le Parti, notamment en ce qu’il manque de démocratie en interne. [39] Néanmoins, ces provocations se tariront rapidement : la méfiance des communistes croit à vue d’œil, s’il est nécessaire de les rassurer pour parvenir à influencer leur politique culturelle, les surréalistes n’hésiteront pas à tout entreprendre pour parvenir à leurs fins. Utilisant l’adhésion comme « un moyen pour eux de crédibiliser leur engagement » [40] , plusieurs membres du surréalisme adhéreront au Parti communiste. Carole Reynaud Pagliot raconte que :
« Desnos, Malkine, Morise, Tual refusent d’adhérer. Ernst, Prévert, Tanguy, Leiris déclarent adhérer mais se rétractent par la suite puisque seuls Aragon, Breton, Eluard, Unik adhèrent début 1927, alors que Péret est déjà membre depuis quelques mois. » [41]
Breton, dont les communistes se méfient particulièrement, devra faire face à de multiples interrogatoires pour faire valider son adhésion. [42] Celui-ci compte bien devenir communiste, même si cela devait lui coûter plus tard une expulsion [43]. Après avoir fait l’expérience d’une vie militante harassante [44], dans des cellules « révolutionnaires » les isolant, les surréalistes se trouvent rapidement face à un dilemme. En effet, le Parti communiste commence à développer des stratégies afin de disloquer et de diviser le mouvement surréaliste de l’intérieur. En premier lieu, celui-ci leur demande de désavouer la revue, Légitime Défense et de placer sous contrôle leur journal, La Révolution surréaliste. [45] Breton, qui s’exécutera non sans mal, décidera intempestivement qu’il quitte le Parti, suite à des problèmes internes dans sa cellule communiste. [46] Suite à ces événements, les derniers surréalistes à être membres du Parti subiront un nouvel assaut des membres du P.C. : il ne suffit plus de désavouer ses propres revues, il s’agit désormais de renoncer au projet même du surréalisme [47] et de dénoncer les membres considérés comme non-sains de leur propre cercle. [48]
Si l’on ignore ce qui l’aura motivé dans cette affaire, seul Aragon sera capable de renoncer au mouvement surréaliste. Il désavouera le Second Manifeste du Surréalisme d’André Breton et se désolidarisera de Freud. [49] Les membres restants dans le mouvement surréaliste recevront extrêmement mal le volte-face d’Aragon. Aragon sera exclu en 1932 par le mouvement surréaliste.
S’en suivra rapidement, en 1934-1935, une coupure avec le Parti et les idéologies communistes. [50] Tous les surréalistes membres du Parti communiste, à part Aragon, se désengagent et retournent à leurs préoccupations libertaires.
Se battant pour de nouvelles causes (telles que la Guerre d’Espagne [51] ou la lutte antifasciste [52]), les surréalistes mettront des années à faire leur deuil de leur vie communiste, gardant probablement un goût d’amertume, voire de déception en arrière-gorge. Qu’importe, les surréalistes se seront rendus compte des conséquences d’une affiliation politique avec un parti existant, et en soi, auront probablement pu tirer des enseignements de cette expérience houleuse, et parfois corrosive.
Références
[27] Ibid. p. 63
[28] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes, op.cit. p. 68
[29] Ibid. p. 68
[30] Ibid. p. 69
[31] Ibid. p. 74
[32] LEIRIS Michel, Journal, 1922-1989, édition établie, présentée et annotée par Jean Jamin, Paris, Gallimard, 1992, p.111, cité par REYNAUD PAGLIO Carole, Parcours politique des surréalistes…, op.cit. p. 74
[33] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes…, op.cit. p. 77
[34] Ibid. p. 80
[35] Ibid. p. 78
[36] Ibid. p. 114
[37] Se définit comme étant : « un art populaire, sain, jeune et clair, qui illumine et qui soutienne, en même temps qu’il exprime le grand cri des masses vers l’affranchissement (…) Nous envisagerons, nous susciterons de nouvelles formes d’œuvres qui se rapprocheront des riches et profondes créations populaires antérieures à la centralisation administrative du classicisme et à la stagnation qu’a amenées ce formalisme pendant son long règne absolu. » BARBUSSE Henri, L’Humanité, 28 avril 1926, « Un nouvel élan », cité par REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes », op.cit. p. 84-85
[38] Ibid. p. 81
[39] Ibid. p. 87
[40] Ibid. p. 90
[41] Ibid. p. 91
[42] Ibid. p. 91
[43] PV de la réunion du 23 novembre 1926, présenté et annoté par BONNET Marguerite, Adhérer au Parti communiste ?, op.cit. p. 32
[44] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes », op.cit. p. 92
[45] Ibid. p. 92
[46] Ibid. p. 93
[47] Ibid. p. 114
[48] Ibid. p. 123
[49] Ibid. p. 115
[50] Ibid. p. 155
[51] Ibid. p. 171
[52] Ibid. p. 155