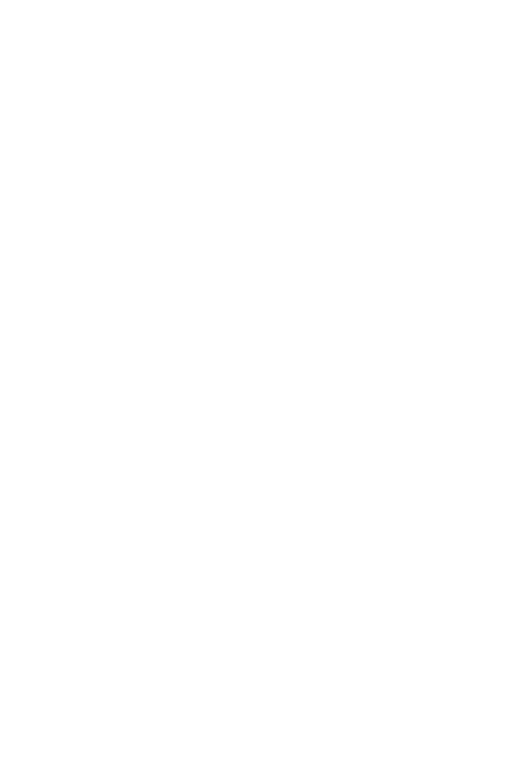GESTES CIRCONVOLUTIONNAIRES
A présent, il convient de revenir sur la configuration du devenir et de l’agir révolutionnaire chez les surréalistes. En quoi consiste un geste révolutionnaire pour les surréalistes, et qu’y a-t-il de subversif dans leur projet ? Qu’est-ce que pour eux, la révolution ? Leur perception de la révolution coïncide-t-elle avec celle des bolcheviks ? Pourquoi parler d’échec politique chez les surréalistes ? Pour répondre à ces questions, il importe d’opérer une importante distinction : celle qui sévit entre la teneur du projet surréaliste en tant qu’attitude pouvant mener à la production d’œuvres, et de la teneur du geste révolutionnaire à proprement dit. Car si selon les surréalistes, un poète est toujours révolutionnaire [53], toutes les œuvres ne sont pas considérables comme révolutionnaires, et toute révolution n’est pas forcément d’ordre poétique. Voir l’exemple que voici :
« Bien entendu aucune question d’ordre esthétique ne doit motiver votre jugement. Si un membre du groupe publie un écrit d’esprit révolutionnaire d’une très grande faiblesse littéraire, cela le regarde personnellement. Vous pouvez alors lui donner votre avis, formuler vos critiques d’un point de vue strictement amical. Pour conclure à la non-publication d’un écrit il ne saurait être question que de s’appuyer sur le caractère non-révolutionnaire de cet écrit. Est contre-révolutionnaire tout écrit qui soutient directement ou indirectement les idéologies bourgeoises sur tous les plans : moral, politique, économique, philosophique. Dépister dans les écrits des membres du groupe ces idéologies souvent persistantes, sournoises, tel doit être votre souci essentiel. Un écrit, naturellement, peut être révolutionnaire de deux façons. Directement (satires, pamphlets, essais, critique historique, ect.) ou indirectement (manifestations dites plus spécialement artistiques de l’activité littéraire). Il ne saurait être question de n’admettre comme révolutionnaire que les écrits de la première sorte. Tout écrit en général qui tend à dissocier, à nier, à détruire les valeurs morales et sociales que la bourgeoisie met en avant, simplement même à détruire la confiance que les gens ont encore en elle est révolutionnaire, quelle que soit sa technique, quel que soit le procédé auquel il ait recours. » [54]
L’acidité révolutionnaire devrait donc à travers l’action poétique, causer en incidence l’érosion de certaines valeurs de l’instance de domination en vigueur ; si l’on considère qu’une œuvre peut se positionner symboliquement comme force à pied d’égalité de sa sphère de réception (qui est généralement bourgeoise), renversant ainsi progressivement le paradigme qui les tient ensemble dans un sentiment esthétique de nature proprement hégémonique, on peut considérer que les surréalistes font preuve d’une logique subversive [55]. On pourrait alors gager que si c’est dans le monde artistique de leur époque que les surréalistes ont mené involontairement leur révolution, ils ne sont cependant pas parvenus à leurs fins révolutionnaires, sur un plan politique ; c’est du moins l’avis de Sartre, qui juge les surréalistes parfaitement insuffisants sur la plan de la praxis, lequel ira jusqu’à les accuser de perdre pied avec le réel et de faire preuve d’idéalisme irresponsable [56]. Leur effectivité révolutionnaire a plutôt cours au travers leur logique d’inversion des codes en vigueur dans la sphère bourgeoise. Néanmoins, on observe également une force subversive dans les productions non-révolutionnaires surréalistes : pour comprendre en quoi leurs travaux ont pu subvertir l’ordre dominant des sphères autonomes du monde de l’art et de la littérature de leur époque, il convient d’observer sous quelle logique sous-jacente ceux-ci se déploient.
Les œuvres surréalistes ont la caractéristique d’habiter ou de créer une tension à l’aide d’éléments hétérogènes, formant ainsi un écart et/ou une contradiction au sein même de leurs réalisations. Prenons l’exemple de la célèbre phrase de Lautréamont, revendiquée par les surréalistes : en effet, le surréalisme est …« Beau comme la rencontre d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection ». En interrogeant cette phrase, on se rend compte au prix d’une rapide auto-observation, que c’est à partir d’une logique analogique, propre aux associations d’idées que l’on peut en extraire du sens. Il s’agirait de faire rhizome [57] entre les termes proposés (comme sans aucuns rapports évidents à prime abord), et de générer chez le lecteur une interprétation singulière. En soi, on ne peut même comprendre un texte ou une œuvre surréalistes sans travailler son flot d’entendement de façon analogique ; ce qui importe, c’est les réseaux d’idées subalternes qui se constitueront au travers du flux interprétatif. Il y a donc souvent un élément manquant, un « trou dans la chaîne » discursive d’un texte surréaliste. Ce trou est ce qui va laisser la vacuité nécessaire à l’imaginaire pour faire rhizome avec les éléments hétérogènes, quoique entièrement propices à la combinaison. [58]
« Un poème surréaliste ressemble à une pyramide renversée débutant par un mot ou un accouplement de mots rapprochés inconsciemment, qui provoquent l’éclosion de l’image. Celle-ci crée un champ magnétique par lequel d’autres images sont aimantées, et où elles se multiplient dans des directions quelquefois choisies délibérément par l’auteur, mais qui dans d’autres cas, dépendent de forces spontanées et fortuites. » [59]
La réunion des opposés au sein d’un complexe contradictoire est le propre de la logique créatrice du surréalisme. André Breton était d’ailleurs connu pour son don à faire tenir ensemble des contradictions. [60] Sur un tout autre plan, il est noté qu’un droit moral à la contradiction est par ailleurs évoqué dans le Procès-Verbal de l’assemblée du 23 novembre 1926 [61], à partir d’ailleurs de la revendication d’une affiliation spirituelle avec Lautréamont. Dans le même ordre d’idées, les surréalistes s’opposeront au rationalisme [62], idéologie « sévissant comme jamais autour des années 20 » [63], qu’ils percevront comme « une recherche calculée et calculatrice d’un bonheur limité et prudent », requérant « le renoncement au rêve et aux exigences essentielles du désir ». [64] En effet, le rationalisme est pour eux une des principales stratégies idéologiques qui tendent à bloquer à la source tout élan créateur. [65] L’écriture automatique est une de leurs premières réponses à ce problème [66]. Ils réagiront par ailleurs à cette tendance instrumentalisante au travers d’une pratique relevant entre autres de l’exploration de l’inconscient, des états hallucinatoires, voire de la folie elle-même [67].
Plus qu’un ensemble de méthodes para-psychanalytiques, le travail surréaliste consiste à malaxer sa propre glaise psychique, en vue d’en extraire des matériaux, au bord de la conscience :
« C’est alors que nous avons pu constater que nous étions en présence d’une matière singulièrement mouvante, non seulement où le langage retrouvait sa puissance germinative mais encore où les symboles foisonnaient. » [68]
Aussi, précisons d’emblée que si une opposition a-logique [69] au rationalisme peut se faire valoir et à juste titre comme un positionnement politique, celle-ci veut également signifier qu’il y a recherche du seuil qui siège entre les données irrationnelles et les instruments de la Raison [70]. Entendons encore Breton sur la question :
« (…) on peut s’attendre à ce que le rationnel épouse en tous points la démarche du réel, et effectivement, la raison d’aujourd’hui ne propose rien tant que l’assimilation continue de l’irrationnel, assimilation durant laquelle le rationnel est appelé à se réorganiser sans cesse, à la fois pour se raffermir et s’accroître. » [71]
Références
[53] CHENIEUX-GENDRON Jacqueline, « Breton, Arendt : Positions politiques, ou bien responsabilité et pensée politique ? », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p.85
[54] Note en fin du procès verbal de la séance du Comité du 5 novembre 1925, qui semble de la main de Crastre, présentée et annotée par BONNET Marguerite, Vers l’action politique, juillet 1925 – avril 1926, Archives du surréalisme II, 1992, éditions Gallimard.
[55] Voir « Corps d’intentions »
[56] SHERINGHAM Michael, « Subjectivité et politique chez Breton » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p.107
[57] Concept deleuzien, utilisé ici en tant que le connecteur-lien embranchant des terminologies dissemblables par nature. Voir l’exemple de l’abeille et de l’orchidée dans DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, « Rhizomes », 1980, éditions de Minuit.
[58] On retrouvera par exemple ce type de procédé dans Roue de Bicyclette de Marcel Duchamp.
[59] WEISGERBER Jean, Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, vol. II, 1984, Comité de Coordination de l’Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes, p. 401
[60] BURGER Peter, « De la nécessité de l’engagement surréaliste et de son échec », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 60
[61] ELUARD Paul : « Nous avons toujours fait profession d’admirer Lautréamont absolument. Même communiste, je ne le désavouerai jamais. Nous avons toujours admis et réclamé pour chacun le droit de se contredire. » Présenté et annoté par BONNET Marguerite, Adhérer au Parti communiste ? Septembre – décembre 1926, Archives du surréalisme III, 1992, éditions Gallimard.
[62] BRETON André, Qu’est-ce que le surréalisme ? 1934, Œuvres complètes, tome 2, édition établie par Marguerite Bonnet, Gallimard, p. 226-227, cité par REYNAUD PAGLIOT Carole, dans Parcours politique des surréalistes, op.cit. p. 23
[63] BRETON André « Le surréalisme et la tradition », dans Ecrits sur l’art et autres textes, Œuvres complètes IV, dirigé par BONNET Marguerite, 2008, éditions Gallimard p. 945
[64] ALQUIE Ferdinand, Philosophie du surréalisme, op.cit. p. 23
[65] BRETON André « Le surréalisme et la tradition », dans Ecrits sur l’art et autres textes, op.cit p. 945
[66] Ibid. p. 945
[67] ALQUIE Ferdinand, Philosophie du surréalisme, op.cit. p. 32
[68] BRETON André « Le surréalisme et la tradition », dans Ecrits sur l’art et autres textes, op.cit p. 945
[69] ALQUIE Ferdinand, Philosophie du surréalisme, op.cit. p. 59
[70] Cette optique sera d’ailleurs très peu au goût des communistes, qui nieront absolument toute opération différantielle de ce type au profit d’une seule dialectique hégélienne. Cf. Présenté et annoté par BONNET Marguerite, Adhérer au Parti communiste ? Septembre – décembre 1926, Archives du surréalisme III, 1992, éditions Gallimard. p. 61)
[71] BRETON André « Crise de l’objet », dans Ecrits sur l’art et autres textes, op.cit p. 682