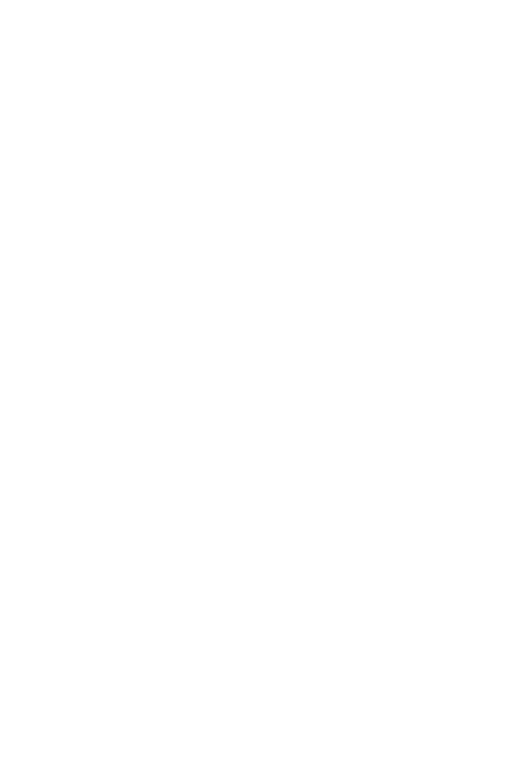L’un des premiers chevaux de bataille des surréalistes sera la libération de la poésie et du langage, et par elles, de la vie elle-même [72]. Le langage est récusé sous sa forme utilitaire, communicationnelle. [73] On casse, on broie le langage pour lui octroyer de nouvelles forces vives [74], et pour éviter d’encastrer ses productions dans les carcans de la littérature classique. Mais contrairement à celles des dadaïstes, les productions surréalistes n’ont pas besoin d’élaborer des ruptures syntaxiques ou de désintégrer à proprement dit la parole. [75] En somme, les surréalistes souhaitent faire de leur mouvement un « instrument d’émancipation du cadre de l’écriture ». [76]
On a vu que les surréalistes s’érigeront contre le paradigme du primat de la Raison, et qu’ils feront éclater les conventions, les modèles de la poésie, de l’art. En ce qu’ils s’insurgent contre une instance idéologiquement dominante, les surréalistes se fondent sur une logique subversive, laquelle confère absolument à leurs processus artistiques et poétiques un statut équivalent. Mais, s’il est vrai que les enjeux surréalistes sont subversifs :
« (…) il est (également) vrai que ni la volonté de briser les règles grammaticales ou picturales traditionnelles ni le recours systématique à la psychanalyse ne suffisent pour conférer une valeur révolutionnaire à une œuvre d’art (…). » [77]
Si ces enjeux ont une pleine pertinence sur le plan artistique (dans le sens où une telle opposition à l’ordre de la Raison ne s’était encore jamais présentée avant eux de manière si affirmée dans l’histoire de l’art, bien certains précurseurs soient à relever… [78]), ils ne le sont pas forcément d’un point de vue révolutionnaire. L’œuvre n’est considérée comme telle que si elle contient ce zeste corrosif qui opère sur les valeurs de la sphère bourgeoise, geste qui se lira avec succès dans les productions du mouvement Dada par exemple. Les œuvres surréalistes ne seront par conséquent pas toutes révolutionnaires (ni par ailleurs toutes subversives !), mais garderont une valeur artistique au travers de la novation de leurs sujets et enjeux. Les découvertes formelles et stylistiques ne sont pas valorisées comme productions d’urgence et menant à des découvertes majeures chez les surréalistes, cela car une recherche de nature uniquement formaliste ne constituent pas un programme particulier dans le projet surréaliste [79] ; la forme n’est que le moyen, et non une fin en soi ; les enjeux priment sur la forme. [80] En effet :
« Mais en même temps il insiste (Breton) que si certaines formes sont dépourvues de toute capacité de contribuer à l’effort révolutionnaire, l’expérimentation formelle ne peut jamais être considérée comme révolutionnaire en elle-même. Le surréalisme n’est pas un moyen d’expression mais « un moyen de libération totale de l’esprit », une « sommation totale », embrassant l’activité humaine sous toutes ses formes. » [81]
Ces considérations nous mènent à saisir pourquoi les surréalistes se prêtent si assidûment, tout au long de leur vie, à distinguer les notions de « surréalisme » et de « pratique révolutionnaire ». Si l’on récapitule, pour les surréalistes, une œuvre est révolutionnaire et subversive si elle s’oppose drastiquement aux valeurs propres à la bourgeoisie ; une œuvre est subversive mais pas révolutionnaire si elle prend à rebrousse poil les codes du paradigme dominant en vogue dans la sphère du monde de l’art et de la littérature, en proposant des formes nouvelles d’expression ; une œuvre n’est ni subversive ni révolutionnaire si elle vante ou tiédie face aux valeurs de l’instance de domination effective (qu’elle soit d’ordre politique ou culturel), voire si elle collabore avec elle. On comprend qu’une œuvre subversive est directement interdépendante de l‘instance de domination, sans laquelle elle ne tirerait aucune force, alors qu’une œuvre non-subversive a tendance à faire éluder à son créateur la dangerosité propre à une affiliation avec des formations détentrices de pouvoir, préférant, plutôt que la lutte, faire pacte avec elles ; alliance fondée sur des intérêts réciproques (le « win-win »). On pourrait facilement réduire ces deux positionnements à des étiquettes de résistant/collaborateur, progressiste/conservateur, néanmoins, les choses ne sont pas si duales. Il arrive que certains artistes, plutôt contemplatifs, dénient simplement l’instance de domination au profit de leurs seuls approfondissements personnels. C’est par exemple le cas pour des mouvements introspectifs tels que l’Arte Povera et le Land Art (à propos desquels : la fuite élégante devant le capitalisme ne constituent en rien une attitude de collaboration). L’œuvre subversive serait celle-ci qui de manière générale s’oppose à une instance de domination, et une œuvre révolutionnaire serait celle qui spécifiquement s’attaque au régime dominant sur un plan politique.
Références
[72] BRETON André « Le surréalisme et la tradition », dans Ecrits sur l’art et autres textes, op.cit p. 945
[73] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes, op.cit. p. 22
[74] Générer une singularité (mouvement subversif), fracassant ainsi des universaux, voir DELEUZE Gilles, Qu’est-ce que la philosophie ?
[75] WEISGERBER Jean, Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, vol. II, op.cit. p. 402
[76] JANOVER Louis, Surréalisme, art et politique, op.cit. p. 111
[77] Ibid. p. 107
[78] On notera tout de même l’influence de Goya, puis des romantiques et des symbolistes, qui auront ouvert la porte aux surréalistes à ce genre de pratique. Dans la littérature, Breton citera Ducasse et Rimbaud, en tant que ceux-ci sont capables de mettre « en déroute de toutes les habitudes rationnelles, éclipse du bien et du mal, réserves expresses sur le cogito, découverte du merveilleux quotidien. Le dédoublement de la personnalité géométrique et celui de la personnalité poétique se sont effectués simultanément. » dans BRETON André, « Crise de l’objet », Ecrits sur l’art et autres textes, Œuvres IV, op.cit. p. 681-682
[79] Voir « Corps d’intentions ».
[80] Cela se justifie encore une fois par la parole de Crastre dans le Procès Verbal de la séance du Comité du 5 novembre 1925, voir cité plus haut dans le texte.
[81] SHERINGHAM Michael, « Subjectivité et politique chez Breton » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 108