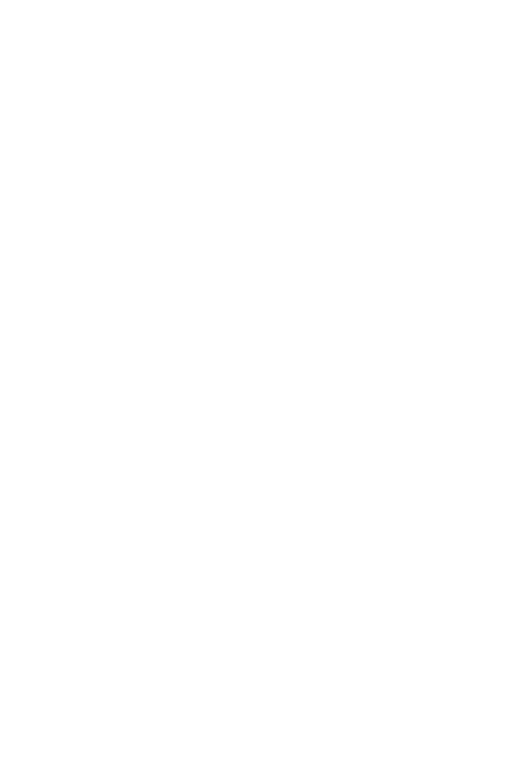DU SOULEVEMENT : QUAND LA REVOLUTION DEVIENT AXE-MOTEUR
Il convient à présent de se pencher sur la notion de révolution chez les surréalistes. A tout bien considérer, le surréalisme a, simultanément à ses corollaires avant-gardistes, inauguré dans l’histoire l’attitude révolutionnaire comme possiblement inhérent au procès artistique :
« (…), « la révolution » reste l’une des plus grandes « découvertes » de l’avant-garde. Eriger la subversion en principe fondamental, assimiler la « création » à la « révolte » (« créer est révolte »), concevoir celle-ci en tant que source et condition de la poésie, voilà le propre de ces mouvements. Ce n’est donc pas par hasard que toutes les avant-gardes du XXe siècle se réclament de cette idée, véritable fil d’Ariane dans leurs prises de position. A telle enseigne qu’elle en devient un cliché, un topos : « avant-garde » veut dire « révolution ». [82]
Sujet de vastes et d’interminables débats, la révolution se verra prendre nombre de définitions tout au long des différents parcours de vie des surréalistes. Cependant, une définition, officielle, fort calquée et déterminée d’ailleurs par le modèle marxiste, scellera le jour de leur assemblée constitutive en 1925 la perception que se feront les surréalistes de ce phénomène – du moins pour de nombreuses années -. En effet :
« Il est impossible d’assigner des buts immédiats à notre action : celle-ci ne saurait être conditionnée que par son but lointain, sa fin dernière, la Révolution. La Révolution ne peut être conçue par nous que sous sa forme économique et sociale où elle se définit : La Révolution est l’ensemble des événements qui déterminent le passage du pouvoir des mains de la bourgeoisie à celles du prolétariat et le maintien de ce pouvoir par la dictature du prolétariat. Le Comité croit nécessaire d’attirer à nouveau l’attention des membres du groupe sur cette définition ; il n’en tolérera aucune autre tentative de révision individuelle, conformément aux décisions de l’assemblée constitutive.» [83]
Nous sommes à ce moment-là en 1925, et les surréalistes projettent encore une adhésion au P.C. ; on voit en effet, à travers ce court témoignage, que les surréalistes sont à la fois obligés d’user d’un jargon marxiste pour se faire entendre par le Parti, et qu’ils sont également convaincus à cette époque du bien-fondé des méthodes du mouvement communiste. En effet, les surréalistes ne réitéreraient pas les mêmes mécanismes disciplinaires (figer une définition, par nature intersubjective) s’ils ne croient pas que le Parti communiste faisait usage d’une méthodologie appropriée. [84] Peter Bürger pense que les surréalistes ne s’engagent pas auprès des communistes pour préparer une révolution, mais bel et bien pour fuir leurs propres « problèmes insolubles ». [85] S’il ne nous appartient pas de soutenir la sentence de Peter Bürger, il peut être dit que les surréalistes pouvaient à la fois être motivés par leur désir collectif de révolution, et tiraillés individuellement par leurs problématiques internes récurrentes. Cependant, malgré ce que prétend Peter Bürger, les surréalistes semblent croire en la Révolution bolchevique :
« De telles dispositions m’ont paru si atterrantes (cf. dispositions fascistes) que je m’en fusse voulu de prendre ici la parole (…) pour affirmer qu’aujourd’hui plus que jamais la libération de l’esprit, fine expresse du surréalisme, aux yeux des surréalistes exige pour première condition la libération de l’homme, ce qui implique que toute entrave à celle-ci doit être combattue avec l’énergie du désespoir, qu’aujourd’hui plus que jamais les surréalistes comptent pour cette libération de l’homme en tout et pour tout sur la Révolution prolétarienne. » [86]
Néanmoins, il est à remarquer que, plus tardivement (aux alentours des années 50), les surréalistes alors extraits du Parti depuis une dizaine d’année, se prêteront à distinguer deux objectifs inhérents à la révolution : le premier se voulant agir au travers d’actions directes, c’est-à-dire par un processus insurrectionnel de renversement, armé, de l’instance de domination en vigueur, le second répondant au désir de bouleverser les structures mentales. [87] Si la première optique a pu plaire et correspondre aux vues des communistes en 1925, la seconde témoignera de la fin de l’adhésion idéologique aux principes du marxisme-léninisme. On peut lire ce volte-face comme un retour à l’intersubjectivité, initialement inhérente au projet surréaliste. [88]
Pendant des années, les surréalistes plaqueront sur le phénomène de la révolution des calques issus de leur contact rapproché avec le bolchevisme. Ils ne pensent pas forcément qu’il soit envisageable que la révolution puisse prendre une autre forme que celle qu’a prit la Révolution russe, et ils ne se prêtent pas par conséquent à en imaginer une forme nouvelle. Joë Bousquet mettra pourtant les surréalistes en garde contre ce genre de réflexe :
« Cela, que je laisse à votre esprit le soin d’achever, par le simple souci de sauvegarder en moi la pensée qu’une révolution sociale, pour être léniniste, ne doit pas copier la révolution russe expression de Lénine, mais se développer selon les lois mêmes d’extase « logique » (oui), d’élaboration intérieure, et de tension vers le but qui ont permis au communisme d’établir sa physionomie vivante et actuelle. Nous ne connaissons pas exactement la nature du feu qui couve en nous. (…) Je crois ne contredire en rien l’immense Trotsky qui dit quelque part, je crois : « C’est la rigueur de l’autorité qui fait la vigueur de la révolte. » L’instrument d’une révolution occidentale ne doit-il pas être plus souple ? » [89]
Mais s’ils restent fixés sur l’idée que leur seul moyen de devenir simultanément surréaliste et révolutionnaire consiste en une adhésion au Parti Communiste, tout en essayant malgré les pressions de conserver une autonomie surréaliste, ils restent néanmoins doués d’une puissante machine imaginative qui va déployer chez eux des forces vives, propres à l’impulsion révolutionnaire qui les anime. La Révolution d’Octobre est pour eux la « preuve » vivante qu’un mouvement révolutionnaire peut exister, et renverser une instance de domination en place depuis longtemps. Ce mythe alimente considérablement leurs désirs. Même si celles-ci resteront au stade d’impulsion et ne mèneront à aucune création politique à proprement dit, la révolution deviendra pour eux un moteur collectif de création. Les surréalistes rêveront la révolution au travers de leurs projections mentales, et les feront fructifier au sein de leur imaginaire. Comme dit plus haut, les traces de leur impulsion révolutionnaire se trouveront sous-jacentes aux œuvres, au travers de leurs enjeux. Jacqueline Chenieu-Gendron, trouvera chez Trotsky des propos éclairants sur la question :
« Un troisième lieu d’emprunt serait à chercher du côté de la pensée de l’art révolutionnaire chez Trotsky, où l’on retrouverait une forme inattendue d’individualisme : « toute licence en art » car « l’artiste a reçu de la Révolution une information qui a modifié sa sensibilité et qui est présente, mais cachée, dans son œuvre. L’axe invisible (de l’art) devrait être la Révolution même. » p.86 [90]
La Révolution comme leitmotiv. Si cela ne s’applique pas qu’à eux (dans le sens où tout artiste ayant une vocation subversive peut se trouver concerné par la révolution), il semble assez clair que les surréalistes furent des précurseurs en la matière. Tricottés dans un agencement de dynamiques individuelles fortement portées sur le combat, véritable face-à-face symbolique avec l’instance paradigmatique de décisions, les surréalistes vont vers la révolution avec la même intense conviction qui les pousse à élaborer leur projet collectif, le surréalisme. Joë Bousquet fait le même constat : « Le surréalisme est un ensemble de recherches spirituelles, un état d’esprit, non plus une attitude de refus, mais maintenant, une attitude de combat. » [91] S’il importe de le repréciser, c’est que c’est cette dynamique va fonder et générer tous les corpus d’œuvres surréalistes, puisque « La révolte seule est créatrice, c’est pourquoi nous estimons que tous les sujets de révoltes sont bons » (André Breton). Pour lui, c’est l’inconscient individuel d’un membre qui participer au mythe collectif dont la création serait le surréalisme. [92] Néanmoins, celui-ci se méfiera des distinctions trop appuyées entre individualisme et action collective [93] : l’art nourrit à la fois le moi individuel et bâtit, rebâtit des dynamiques collectives aux visées plus vastes.
Références
[82] WEISGERBER Jean, Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, 1984, Comité de Coordination de l’Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes, p. 638
[83] Présenté et annoté par BONNET Marguerite, Vers l’action politique, juillet 1925 – avril 1926, Archives du surréalisme II, 1992, éditions Gallimard, p.67
[84] « Les débats et les dissensions qui eurent lieu parmi les surréalistes étaient déterminés par leur volonté d’impliquer à leur mouvement les méthodes mêmes du marxisme. » TZARA Tristan, Le Surréalisme et l’Après-Guerre, op.cit. p.28
[85] BURGER Peter, « De la nécessité de l’engagement surréaliste et de son échec », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 62
[86] BRETON André, « Qu’est-ce que le surréalisme ? », Œuvres complètes II, dirigé par BONNET Marguerite, 1992, éditions Gallimard, p. 230
[87] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes, op.cit. p. 253
[88] « La labilité et la mobilité du sujet humain, et les possibilités de transformation sur le plan social seraient directement liées à notre capacité de désentraver les voies de la subjectivité. » dans SHERINGHAM Michael, « Subjectivité et politique chez Breton » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p.117-118
[89] BOUSQUET Joë, dans Vers l’action politique, op.cit. p.29-30
[90] CHENIEUX-GENDRON Jacqueline, « Breton Arendt : Positions politiques, ou bien responsabilité et pensée politique ? », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. 86
[91] Présenté et annoté par BONNET Marguerite, Vers l’action politique, op.cit. p. 28
[92] SHERINGHAM Michael, « Subjectivité et politique chez Breton » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 117
[93] Ibid. p. 108