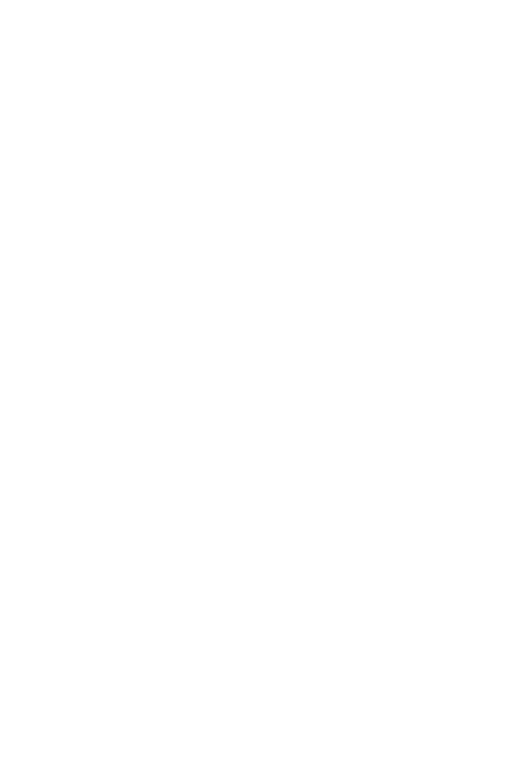DU RÊVE, ET PAS SEULEMENT NOCTURNE
Au même titre que les bolcheviks, les surréalistes sont avant tout de grands rêveurs. Ils se sustentent de projections sur la révolution à venir, et calquent leurs désirs sur cette entreprise virtuelle. Cet appétit imaginaire pour la Révolution reste pourtant valable, même s’il est souvent contrebalancé par des fustigations inhérentes au fait que les surréalistes ne seraient pas parvenus à en extraire quelque chose sur le plan politique.
On notera l’exemple du dadaïste Tristan Tzara se verra déçu par le manque d’effectivité des surréalistes pendant la Deuxième Guerre Mondiale :
« (…) le Surréalisme a été absent des préoccupations de ceux qui sont restés (en France), parce qu’il ne leur fut d’aucun secours ni sur le plan affectif du comportement devant les nazis, ni sur celui, pratique, de la lutte entreprise contre eux. Après ces événements récents dont l’incontestable portée n’a pas atteint le Surréalisme, qui hors de ce monde cherchait une justification à son demi-sommeil béat, je ne vois pas sur quoi celui-ci serait fondé pour reprendre son rôle dans le circuit des idées, au point où il le laissa, comme si cette guerre et ce qui s’en suivit ne fût qu’un rêve vite oublié. » [94]
Plus loin il rétorquera que :
« (…) le Surréalisme n’a pas renoncé à la volonté d’une transformation radicale de la société, mais que, sachant… combien sont illusoires les appels à la conscience (très juste ; on attend ici la proposition d’une méthode efficace), … le domaine qu’il s’est choisi est à la fois plus large et plus profond, à la mesure d’une véritable fraternité humaine. On se croirait revenu au temps de J.-J Rousseau ! A ce désir de fraternité, qui ne souscrirait pas ? Mais les Surréalistes omettent, bien entendu, de montrer comment il faudrait procéder pour pouvoir y parvenir. » [95]
Afin de comprendre pourquoi les surréalistes ne peuvent se proposer de trouver des applications pragmatiques à leurs revendications, il nous faut observer la teneur de leur engagement. En effet, Drieu la Rochelle, théoricien de la notion d’engagement, distingue deux types d’engagements politiques : le première type est fondé sur la pluralité des positions existentielles, qui une fois cristallisée sous forme de décisions prises en commun, permet à chaque individu de dépasser son égocentrisme en faveur d’une mise au service la collectivité [96]. Le deuxième consiste en une attitude de soumission aux buts d’un parti politique existant [97], souvent puissant car capable de se légitimer (donc de légitimer ses membres). Les surréalistes semblent, à partir de ce que nous venons de voir, n’envisager l’agir révolutionnaire qu’à partir d’une affiliation politique à un groupe établi. Walter Benjamin pensera néanmoins que le surréalisme doit sa force révolutionnaire dans sa conception de l’expérience, et en aucun cas avec ses relations avec les partis politiques. [98]
Il est possible de dire que les surréalistes font preuve d’une perception transcendantale de « la » politique [99], à l’instar d’une autre perception (« du » politique cette fois), reposant sur l’immanence : ils ont vu en quelque sorte les solutions en dehors d’eux-mêmes. Il est par conséquent possible d’émettre l’hypothèse que c’est en s’affiliant à un parti existant que les surréalistes s’ôtent la possibilité de générer leur propre mouvement politique. C’est du moins un avis partagé par Peter Bürger, sous la plume d’Effie Rentzou :
« La remarque de Bürger renvoie à un point de vue qui veut que l’implication politique et le potentiel révolutionnaire de l’avant-garde soient corrélés à l’engagement – total ou avorté – à un mouvement politique. La conséquence d’une telle perspective est que, finalement, la seule relation que l’avant-garde puisse entretenir avec la politique est le plus souvent figurée en termes d’action dans un cadre précis d’activité politique. Il n’est donc pas surprenant que suivant ce fil de pensée d’aucuns parlent de l’échec de l’avant-garde selon la logique sous-jacente : la révolution sociale n’a pas lieu, l’avant-garde a manqué son rôle de transformateur du monde ; la révolution artistique, en tant qu’abolition de l’autonomie de l’art, n’a pas eu lieu non plus ; l’avant-garde a donc échoué dans ses deux projets. » [100]
Si les surréalistes avaient pris un peu plus attention à leur vie micropolitique, soignant leurs relations en tant qu’individus travaillant « avec leurs pairs », peut-être auraient-ils plus facilement détecté qu’il était envisageable de tirer des possibles de nouveaux modèles, qui leurs soient propres, parfaitement calibrés sur leurs lignes de fuite [101]. Plus prompt à faire émerger une singularité, une création collective.
En effet, ceux-ci ont occulté qu’ils pouvaient agir de façon immanente, à partir de leur propre matériau : c’est-à-dire sur son propre être et à partir sa capacité à vivre-ensemble avec, pour la collectivité. Pour justifier les critiques entreprises sur le compte de la vie micropolitique des surréaliste, il suffit de se pencher sur un exemple de l’assemblée du 23 novembre 1926 : celui du jugement d’Antonin Artaud. On y voit très clairement les rapports électriques à la limite de la méchanceté que les surréalistes entretiennent entre eux. On note également une certaine partialité idéologique : ne sont pas exclus, et ne sont respectés, que ceux qui adhérent de façon inébranlables au P.C.
Références
[94] TZARA Tristan, Le Surréalisme et l’Après-Guerre, op.cit. p. 78
[95] Ibid. p. 80
[96] BURGER Peter, « De la nécessité de l’engagement surréaliste et de son échec », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 64
[97] Ibid. p. 64
[98] BENJAMIN Walter, Le Surréalisme. Le dernier instantané de l’intelligence européenne , dans Œuvres « I. Mythe et Violence », 1971, éditions Denoël Les Lettres Nouvelles, cité par RENTZOU Effie, « Dépayser la sensation, surréalisme ailleurs – repenser le politique » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p.184
[99] Comprendre la distinction entre « la » politique et « le » politique de la manière suivante : « la » politique désigne la politique officielle, étatiste ou institutionnalisée, alors que « le » politique concernera plutôt les micro-espaces collectifs, comme dans le cas d’une micropolitique.
[100] RENTZOU Effie, « Dépayser la sensation, surréalisme ailleurs – repenser le politique » dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 183-184
[101] Suivre ses lignes de fuite : concept deleuzien désignant le fait de suivre attentivement et passionnément ses horizons personnels en fonction de ses problématiques latentes et de ses aspirations profondes. Voir DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille plateaux, op.cit.