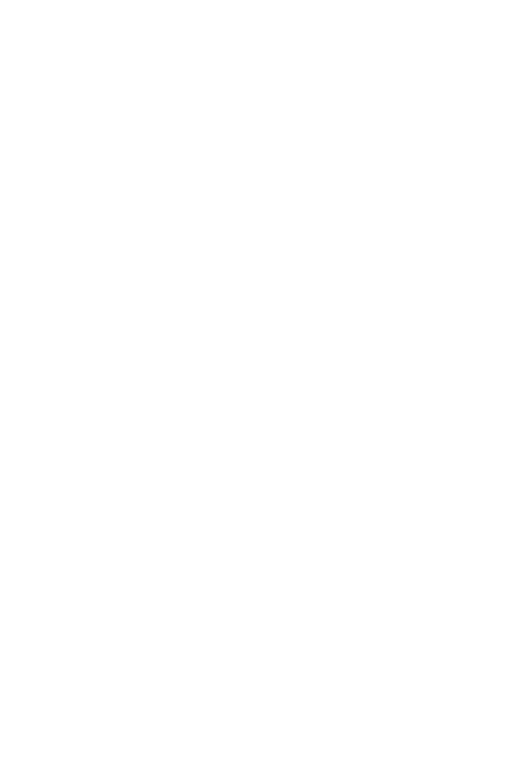IM(POSTURE) ?
Si les surréalistes n’ont ni créé un nouvel ensemble de « remèdes » socio-politiques, ni véritablement pu agir en interne à partir de leurs propres champs relationnels, que reste-t-il chez eux, de politique, au-delà de leurs intrications avec le bolchevisme ?
Ne faisant effectivement pas preuve d’une grande créativité politique (créativité qui restera d’ordre artistique), il reste néanmoins à souligner que les surréalistes n’ont pas été inefficaces. En effet, il est une chose dont les surréalistes sont restés « des maîtres en la matière ». Leur force politique est régie par leur capacité à se positionner comme révolutionnaires ; en effet, les surréalistes ont introduit dans le champ de l’histoire de l’art et de la création littéraire plusieurs caractéristiques novatrices. Janover dira que :
« Dès l’origine, en effet, se dessine dans les positions défendues par le groupe une double tendance : d’une part, on peut déceler certains éléments d’une critique radicale de la fonction même de l’artiste dans la société, critique qui offre, aujourd’hui encore, d’incomparables possibilités de subversion et dont on n’a pas fini de dégager toutes les implications révolutionnaires ; d’autre part, on assiste à l’élaboration et à la diffusion d’une nouvelle conception de l’art qui préserve le caractère spécialisé de l’activité artistique, apportant de nouvelles justifications morales aux prétentions élitaires des milieux littéraires et picturaux. » [107]
Il est à noter que les surréalistes amènent un nouvel élément : l’artiste peut devenir révolutionnaire (sur un plan politique), parallèlement à ses préoccupations artistiques. Il suffit pour cela qu’il se positionne comme tel ; nul besoin de générer un système politique alternatif, nulle nécessité de renverser l’instance de domination en vigueur. Il suffit juste d’en faire la déclaration. Si, rétrospectivement, l’on trouve dans le réalisme, dans les tableaux ouvriers et paysans d’un Courbet par exemple, une position politique évidente, celui-ci ne semble pas pour autant avoir générer un pareil mythe autour de sa posture. La fonction de l’artiste n’est plus, avec le surréalisme, de créer des objets imitant ou contrastant stylistiquement avec ceux de leurs prédécesseurs, à l’intérieur même de la sphère autonome du monde de l’art et de la littérature, mais bel et bien de se positionner vis-à-vis des tendance sociales et politiques de son époque. Ce déplacement objet/posture va faire l’effet d’une bombe dans le domaine de la création. En effet, sans cet héritage, des expositions comme Quand les attitudes deviennent formes n’auraient simplement pas pu prendre leurs titres légendaires, et de nombreux artistes ne réfléchiraient pas de façon si claire sur les enjeux de leurs positionnements (fussent-ils ambivalents) vis-à-vis de la société marchande [108] ou des abus en matière de pouvoir [109] par exemple.
Tristan Tzara n’hésitera pas à abonder en faveur des surréalistes sur la question de leur positionnement :
« Ayant réduit la création artistique à ses composantes humaines, munis d’un instrument d’investigation assez subtil et d’un bagage de découvertes cohérentes, les surréalistes purent, dès 1929, s’engager plus loin que les dadaïstes dans la pratique révolutionnaire et reconnaître dans le mouvement ouvrier et surtout celui pour qui le marxisme léniniste était la ligne de conduite, l’aboutissement historique vers lequel tendait le monde. » [110]
Avec les surréalistes, il devient possible de faire valoir une posture révolutionnaire, non pour une œuvre à proprement dit, mais pour une forme d’art sans rattachement matériel. D’un autre côté, comme nous l’avons vu [111], les surréalistes amènent dans l’histoire de la création un matériau entièrement neuf : une oeuvre n’a plus seulement un contenu politique intrinsèque, elle peut également renfermer un contenu éthique (fusse-t-il mit en application avec les limites que nous aurons relevé plus haut). C’est le geste symbolique, éthique, la posture révolutionnaire et le mythe (surréaliste) qui font œuvre.
Afin de préciser cette pensée, observons dès lors la manière dont se positionnent les surréalistes vis-à-vis de leur statut d’artistes révolutionnaires, et comment se caractérisent leurs postures. En effet, ceux-ci n’hésiteront pas à se considérer comme étant :
« (…) la révolte de l’esprit : nous considérons la Révolution sanglante comme la vengeance inéluctable de l’esprit humilié par vos oeuvres. [112] Nous ne sommes pas des utopistes ; cette Révolution, nous ne la concevons que sous sa forme sociale. »[113]
Au niveau de son effectivité, les surréalistes se prétendront…
« (…) réellement capable de changer quelque chose dans les esprits », d’inculquer une nouvelle conception de la vie et une nouvelle vision du monde, de remplacer de manière définitive une Weltanschauung par une autre. On verra que la technique proposée se fonde sur tout un système de ruptures, de renversements, de « contrepèteries », y compris l’humour noir, cette « révolte supérieure de l’esprit ». » [114]
Très sûrs de leurs capacités, les surréalistes iront même jusqu’à se considérer comme compétents pour entreprendre un renversement de type perceptuel et une révolution à proprement dit culturelle – ce qui, dans le dernier cas reste, comme nous l’avons vu, très précisément valable – :
« Détenteurs de l’art révolutionnaire, les surréalistes conçoivent leur mission comme celle d’intellectuels révolutionnaires qui vont être les mieux à même, non seulement de donner toute l’impulsion à la politique culturelle du mouvement révolutionnaire (communiste), mais aussi de l’orienter et de la définir. » [115]
Les surréalistes peuvent bien se griser de leurs intentions, reste que des desseins aussi ambitieux sont dangereux à faire valoir. Les raisons sont doubles. La première se révèle en ce qu’il est considérablement déconseillé de faire des promesses que l’on ne peut tenir sur un plan pratique [116]. La deuxième réside en le fait qu’une projection sur un avenir aussi glorieux peut très précisément réitérer le problème que rencontreront les bolcheviks ; les bouffées de puissance comme conséquences d’une projection dans un avenir historique ne sont jamais dues à autre chose qu’à une quête occultée de pouvoir, laquelle ne constituera jamais un motif suffisamment valable et sain pour la création.
Peter Bürger émettra des réserves sur ce genre de gargarisation, privilégiant une attitude rigoureuse d’observation sur la teneur de son engagement personnel :
« Il y a une problématique interne de l’engagement qui ne coïncide ni avec la question des buts politiques ni avec la question développée par Adorno, de la qualité esthétique de l’œuvre engagée. Cette problématique vient du fait que, dans l’acte d’engagement, l’individu se charge de la responsabilité de l’état du monde, ce qui est nécessairement trop lourd pour lui. C’est par une auto-critique de l’engagement qu’il faudrait commencer pour mettre en question cette infatuation virile. L’image grandiose que le personnage engagé se fait de lui-même s’écroulerait d’elle-même, ce qui aurait un effet curatif car cela ferait place à des formes plus modestes d’engagement. »[117]
Aussi tout cela nous mène à interroger frontalement les agirs qui manifesteront ces intentions.
La question est filigrane : que font concrètement les surréalistes pour appuyer leurs revendications politiques ?
L’activité politique des surréalistes se manifestera de prime abord au travers d’une écriture régulière dans des revues, les journaux rédigés par les surréalistes étant le moyen le plus direct de véhiculer leurs idées et prises de position. Il s’agira ici de propagande et de déclarations d’intentions. On les sait pareillement adeptes de la rédaction de tracts, dénonçant notamment les institutions carcérales et psychiatriques (on doit cette tendance à Antonin Artaud). Il est également connu que les surréalistes mirent en place des « actions »[118], qui si mentionnées dans leurs procès-verbaux et dans les ouvrages de leurs commentateurs [119], ne seront jamais clairement explicitées.
Ces pratiques seront conformes à celles en vigueur dans les milieux politiques de l’époque. Il ne serait par conséquent pas faux de penser que les surréalistes n’ont pas fait preuve d’une grande imagination sur les moyens à mettre en place, alors qu’à contrario, ceux-ci se montreront clairement innovants en ce qu’ils tendent artistiquement vers la Révolution.
Références
[107] JANOVER Louis, Surréalisme, art et politique, op.cit. p.25-26
[108] Voir Wim Delvoye ou Paul McCarthy (avec Peter Paul Chocolates par exemple).
[109] Voir Hans Haacke
[110] TZARA Tristan, Le Surréalisme et l’Après-Guerre, op.cit. p.27
[111] Voir « Corps d’intentions ».
[112] Le « vos » concerne « Prêtres, médecins, professeurs, littérateurs, poètes, philosophes, journalistes, juges, avocats, policiers, académiciens de toute sorte », dans le manifeste La Révolution d’abord et toujours, 1925. Dans WEISGERBER Jean, Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, op.cit. p. 637
[113] Cité par ALQUIE Ferdinand, Philosophie du surréalisme, p. 85, à partir des Documents surréalistes de Nadeau, p. 31 à 34
[114] WEISGERBER Jean, Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, op.cit. p. 637
[115] REYNAUD PAGLIOT Carole, Parcours politique des surréalistes, op.cit. p. 76
[116] Avertissement à prendre en compte à titre personnel.
[117] BURGER Peter, « De la nécessité de l’engagement surréaliste et de son échec », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 69
[118] Présenté et annoté par BONNET Marguerite, Adhérer au Parti communiste ? op.cit.
[119] BURGER Peter, « De la nécessité de l’engagement surréaliste et de son échec », dans Surréalisme et politique, politique du surréalisme, op.cit. p. 61