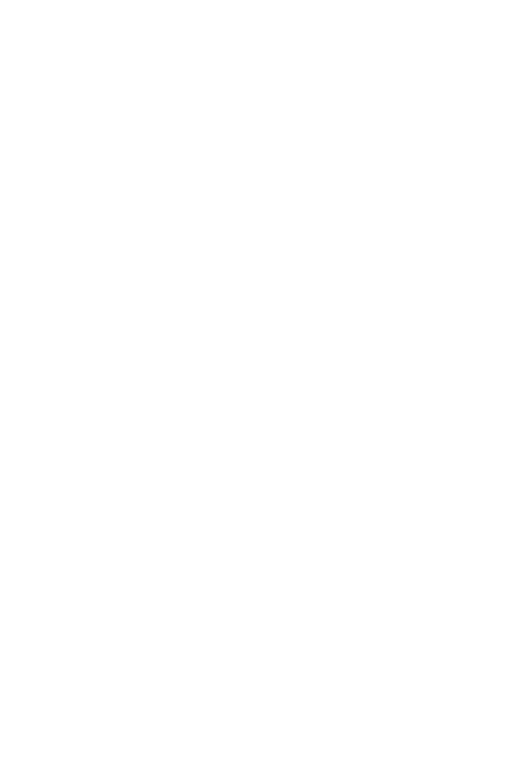Le 5 février, j’ai organisé une vidéoconférence avec Raphael Denis.
Nous avons discuté du Kunsthaus.
Puis il m’a dit que l’une de mes oeuvres l’intéressait pour sa collection : le Sel de Haine.
Le prix de cet objet était à l’époque 4’880.-.
Raphael Denis m’a dit que le Sel de Haine était hors de prix.
Je lui ai répondu que le Sel de Haine était un outil extrêmement puissant, car si quelqu’un l’achetait et le déposait devant une oeuvre, cette oeuvre perdrait 28 %.
Raphael Denis m’a conseillé de faire une série de multiples moins chers liés au sel.
S’en est suivi toute une réflexion sur la valeur des oeuvres d’art.
Raphael Denis m’a parlé de l’une de ses oeuvres sur la question de la valeur, sur laquelle j’aimerais toujours écrire un texte.
J’ai fait une capture d’écran de son visage pour le collage, puis nous avons arrêté la conversation.
J’ai ensuite réalisé un collage sur cette discussion.
Mais à l’époque, je ne demandais toujours pas à mes intervenants de choisir le texte sur le collage. J’ai donc largement déformé ses propos, notant un mélange entre ma réflexion et la sienne.
Cela pose un énorme problème.
La personne représentée sur le collage doit pouvoir choisir son message. Après tout c’est son image qui est en jeu.
Cette situation avec Raphael Denis m’a fait décider demander une phrase au chercheur représenté.
Le 7 février 2024, j’ai rencontré Emilie Widmer, une doctorante de
l’Université de Lausanne.
Emilie Widmer a commencé par me parler des sociétés des beaux-arts.
Nous nous sommes ensuite interrogé sur les raisons pour lesquelles les élites achetaient de l’art.
Emilie Widmer a évoqué le capital culturel et symbolique, la distinction selon Bourdieu.
Emilie Widmer m’a ensuite renseigné sur le patriciat.
Nous avons par la suite discuté des élites économiques montantes, non-intégrées à la haute bourgeoisie.
Emilie Widmer m’a confié que le goût en matière d’art était dicté par une clique de connaisseurs.
Les collections donnent selon elle le goût d’une époque.
Elle m’a dit que durant la période d’Emil Bührle, les collectionneurs étaient scindés en deux camps : les conservateurs et les modernistes.
Nous avons terminé notre discussion sur la philanthropie, la taxant d’opération marketing.
Je suis rentrée chez moi, et j’ai réalisé le collage.
Le 9 février, j’ai rencontré Sébastien Guex.
Sébastien Guex est professeur honoraire à l’Université de Lausanne.
Si notre premier entretien a été une catastrophe, il en a résulté toute une série d’autres rdvs.
Lors du premier rdv, je béguaillais. Sébastien Guex me regardait avec des yeux noirs et je me décomposais. Je n’arrivais pas à aligner une
phrase avec éloquence. J’ai eu très peur de lui, lors de la première rencontre. Je suis repartie déprimée de mon premier contact avec Sébastien Guex.
Finalement, le soir de l’entretien, je lui ai écris un email un peu bizarre qui a dû l’intriguer. Nous avons donc gardé contact.
Au sein de nos divers entretiens, nous avons discuté de nombreuses choses.
Sébastien Guex m’a dit par exemple qu’une grande fortune ayant un capital plus élevée que 50 millions, investissait de la façon suivante :
10 % de leur fortune dans l’art
10 % dans l’or
et 25 % dans l’immobilier.
Pour ne pas perdre sa fortune, une élite va diversifier ses investissements.
La première génération va faire de l’argent, la deuxième génération va consolider la fortune et la troisième génération va acheter de l’art.
Selon Sébastien Guex, ce sont 2000 collectionneurs qui font le marché.
Sébastien Guex n’a pas hésité à dire que pour devenir capitaliste, il fallait fréquenter d’autres capitalistes.
Il m’a dit que la haute bourgeoisie était ultra socialisée.
Le capital, c’est des relations sociales.
Il est même allé jusqu’à déclarer que la culture était une patine en société capitaliste.
Il a affirmé que l’art était un moyen d’entrer dans la haute bourgeoisie.
Puis nous avons parlé du marché de l’art.
Nous avons discuté sur son opacité et sur le fait qu’il était utilisé pour le blanchiment d’argent et le blanchiment de la fraude fiscale.
Il m’a dit que l’argent produit par la prostitution, la drogue, le trafic d’êtres humains, correspondait à plus de 1000 milliards de dollars.
Selon lui, la fraude fiscale, c’est vingt fois cela.
Jusqu’à il y a une dizaine d’année, les entreprises pouvaient défiscaliser les pots de vins pour corrompre les gouvernements étrangers.
Le but de l’évasion fiscale, c’est d’économiser et de préserver la fortune.
D’après Sébastien Guex, les élites inventent des techniques pour pratiquer l’évasion fiscale.
Si elles n’arrivent pas à leurs fins, elles blanchissent.
Sébastien Guex a aussi été déterminant sur un autre aspect.
Lors de notre troisième entretien, il a fortement critiqué mes collages.
Sébastien Guex m’a dit qu’il ne voyait pas de noeud dans mes collages, comme il en voyait dans un Manet par exemple.
Cela m’a énormément ébranlée. Je suis repartie choquée et déprimée de cet entretien.
Cependant, cela m’a énormément fait réfléchir sur mes collages.
Jusqu’à présent, ils n’avaient été que contextuels.
Une photo de l’endroit, une photo de l’intervenant, la date issue d’un journal du jour, un 8, quelques modifications, quelques images trouvées aléatoirement.
Point à la ligne.
Grâce à Sébastien Guex, je suis parvenue à faire de meilleurs collages.
J’ai compris qu’ils devaient pas seulement représenter l’endroit, mais aussi le sujet de la discussion.
Mes collages devaient présenter un aspect plus conceptuel, moins contextuel.
J’ai donc complètement changé ma manière de faire des collages depuis cet entretien.