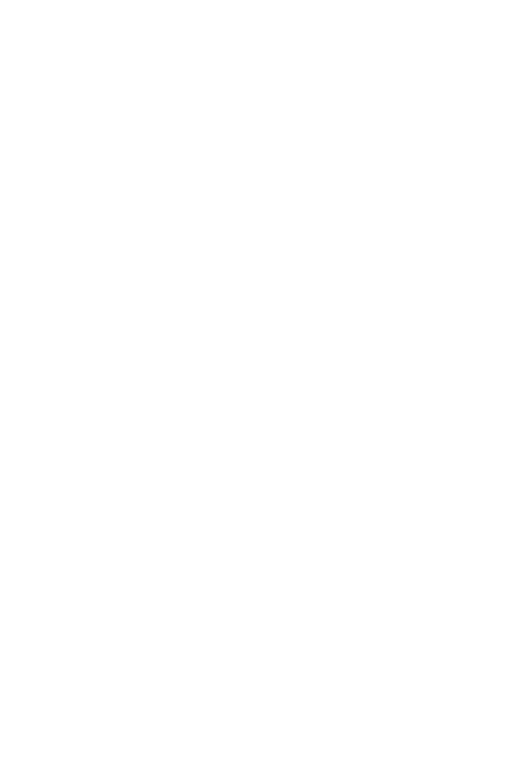Le 26 mars, au matin, j’ai rencontré Matthieu Leimgruber à Lausanne.
Il a commencé par me dire que les plus grands collectionneurs créaient leur propre musée.
Si Emil Bührle avait collectionné de l’art du 18ème siècle, personne ne parlerait de sa collection.
Emil Bührle concentre beaucoup d’aspects qui gênent : étranger allemand, bien que naturalisé suisse, peu humanitaire mais singulièrement prospère, opportuniste car vendant à tous les belligérants.
Emil Bührle est pour lui un capitaliste sans états d’âme qui a constitué une collection de rang mondial.
Mais Matthieu Leimgruber a insisté sur le fait qu’Emil Bührle était un paratonnerre, prenant les foudres à la place des autres.
Nous avons bifurqué sur le fait que le capitalisme est basé sur un mythe méritocratique qui fait croire que chacun peut s’élever socialement.
Evidemment, nous avons conclu qu’il s’agissait bien d’un mythe, et qu’une ascension sociale est rarement possible.
Après cela, nous sommes venus sur Thomas Piketty, qui a écrit Capital et Idéologie.
Au cours du 20ème siècle, on assiste à une certaine déconcentration des richesses.
De nos jours, notre société se retrouve dans une situation où la disparité des richesses est beaucoup plus accrue qu’au 20ème siècle.
Pour clore l’entretien, je lui ai montré des objets réalisés pour une performance que j’allais réaliser deux jours plus tard à la galerie
Andata-Ritorno, à Genève, gérée par Joseph Farine.
Avant l’entretien avec Matthieu Leimgruber, j’avais travaillé toute la nuit sur cette performance. Je n’avais pas dormi.
L’entretien s’est terminé sur des discussions générales sur l’art.
Le 16 avril 2024, j’ai rencontré Stéphanie Ginalski à l’Université de Lausanne.
Stéphanie Ginalski est maître d’enseignement et de recherche en histoire économique et sociale à l’Institut d’études politiques, historiques et internationales. Elle est également la co-fondatrice de l’Observatoire des élites. Son travail sur les élites économiques est remarquable.
Elle m’a parlé de la figure typique de l’élite économique au 20ème siècle. Elle m’a dit qu’il s’agissait souvent d’un homme blanc, suisse,
issu de la grande et moyenne bourgeoisie, qui a gradé à l’armée.
A la fin du 20ème siècle, on assiste à cause de la globalisation à une transformation de la figure du dirigeant.
Une augmentation des étrangers parmi les dirigeants est à observer :
– Moins de 5 % des dirigeants sont étrangers jusqu’à la fin des années 80
– En 2020, 40 % des dirigeants sont étrangers
Stéphanie Ginalski m’a dit que la présence des femmes augmentait dans le corps dirigeant : elle observe une augmentation de 15 % en
2015.
Au cours du 20ème siècle, les descendants de familles patriciennes diminuent.
Stéphanie Ginalski m’a dit que la compétition affaiblissait la cohésion entre les élites.
Ce sont les femmes qui vont tisser des liens par le mariage.
Le mariage permet à certaines personnes de classe moins aisées d’accéder aux sphères hautes bourgeoises.
Nous avons ensuite discuter des raisons d’investir dans l’art. Nous avons évoquer le prestige symbolique, la dimension ostentatoire
et la philanthropie.
Après une heure de discussion, l’entretien s’est terminé.
Stéphanie Ginalski a posé de dos pour le collage, puis je lui ai demandé quelle phrase elle voulait inscrire sur cette oeuvre.
Le 25 avril 2024, j’ai rencontré Dominique Vinck à l’Université de Lausanne.
Dominique Vinck est sociologue et professeur ordinaire à l’Université de Lausanne.
Il s’est fait connaître pour diverses recherches en sociologie des sciences et des techniques, notamment dans un travail sur les nanotechnologies.
Aujourd’hui Dominique Vinck se lance dans la bande-dessinée. Il a créé une bande dessinée en sciences sociales appelées Mitra, dans laquelle il expose toute sa recherche sur le glyphosate.
Dominique Vinck m’a reçu dans son bureau à Géopolis, à l’Université de Lausanne.
Dominique Vinck m’a dit que Bührle s’était peut-être acheté une identité de haut-bourgeois.
Il pense que ce serait notamment pour cela que les critiques tombent sur lui.
Si Emil Bührle faisait déjà partie de la haute bourgeoisie, il n’aurait probablement pas été autant détesté.
Dominique Vinck m’a donné l’exemple du conte dans lequel un crapeau gonfle pour être plus gros que le boeuf.
Il m’a dit que les élites n’achetaient pas de l’art uniquement pour contourner le fisc, mais également pour « s’acheter » une identité
sociale, par exemple de classe sociale, pour montrer qu’ils sont cultivés, charitables…
Dominique Vinck a posé pour le collage dans l’Université de Lausanne, et a choisi la phrase qu’il voulait y voir paraître.
Le soir, j’ai réalisé le collage.
J’ai repensé à son histoire de boeuf et de crapaud.
Sur mon collage, le boeuf représente la haute bourgeoisie, et le crapaud Bührle.
Le crapaud tire avec une arme de Bührle sur Dominique Vinck.
Le fond du collage est une impression modifiée de l’Université de Lausanne, modifiée avec Photoshop.
J’ai collé la date du jour et un 8.